L’impeachment de Trump s’est donc achevé comme il était programmé qu’il se termine : avec un acquittement. Aux deux questions qui leur étaient posées («Le prévenu, Donald Trump, a-t-il abusé de ses pouvoirs ?» et «A-t-il empêché le Congrès de remplir ses fonctions d’enquête?», les Sénateurs ont répondu par la négative. Aussitôt, Trump a pavané, et le cours de la vie politique américaine, dans cette année, très chargée, d’élections présidentielles, a repris comme si de rien n’était. On en retiendra pourtant l’étrange défense, si significative de Trump et du Parti Républicain, pour protéger le Président. D’abord, ils ont nié les faits (à savoir une intervention pour faire pression sur l’Ukraine, afin d’obtenir des informations compromettantes sur le fils de Joe Biden). Puis ils ont nié que ces faits soient si graves que cela. Ensuite, ils ont reconnu que c’était un peu dérogatoire à la loi, voire non constitutionnel, mais sans doute pas un fondement adéquat à une destitution. Enfin, dans les derniers jours de l’impeachment, les cadors du Parti Républicains ont concédé que les faits étaient exacts, qu’ils étaient graves, qu’ils étaient passibles d’impeachment, mais que Trump avait bien le droit de faire ce qu’il voulait. On a donc entendu des sénateurs, comme Marco Rubio, avouer très benoîtement que ce n’était pas parce qu’un acte de Trump était passible d’impeachment qu’il fallait le dire, ou voter en conséquence, soit l’exacte négation de 350 ans d’Histoire des États-Unis.
Enfin, dire que tout s’est passé comme prévu n’est pas totalement juste. La seule surprise du procès d’impeachment est venu de Mitt Romney. Mitt Romney est cette figure de la droite, ancien candidat à l’élection présidentielle contre Obama en 2012, devenu depuis sénateur. Romney a voté pour inculper Trump, sur le premier chef d’accusation, l’abus de pouvoir, et, à de larges égards cela a été la seule surprise, et le seul accroc pour Trump. Une surprise car Romney n’est pas un enragé – un centriste libéral, flou idéologiquement, mais pas vraiment un gauchiste militant. Et un accroc pour Trump et les Républicains. Dans le but de clamer que Trump était victime d’une minorité revancharde, à savoir les Démocrates, les Républicains ont essayé d’enrôler un sénateur démocrate de leur côté, ce qui n’est pas arrivé, l’intéressé, téméraire, mais pas courageux, s’étant finalement rétracté. Puis, les Républicains ont essayé de démontrer que c’était un procès politique : la gauche voterait pour l’impeachment, la droite contre, et l’affaire serait réduite à quelque chose de politicien, et pas à une question vitale, morale, profonde, de ligne entre le Bien et le Mal. Ainsi, qu’un sénateur Républicain vote avec les Démocrates a pulvérisé ce récit.
Depuis, dans les médias, et chez les anti-Trump, Romney est devenu quelque chose comme un saint. Henry Fonda – dont il partage l’élégance patricienne, la coupe de cheveux impeccable, et un air pénétré de rectitude morale – dans «Douze Hommes en Colère» : l’homme qui renverse les conventions et déjoue le conformisme grégaire, pour s’élever comme héraut de la justice. Romney, lors de son discours explicatif, en a d’ailleurs fait des tonnes, sur le thème : «Mes enfants et mes petits-enfants me regardent, je ne peux pas faire voter contre ma conscience».
Le problème, c’est que le récit de Romney est invalidé par deux éléments. D’abord, sa carrière. Romney a toujours été le grand opportuniste de la politique américaine. Gouverneur de l’Utah, il a mis en place une sorte de Sécurité Sociale dans son Etat. Le plan Romney était assez progressiste, mais, quand il s’est présenté contre Obama, le gouverneur a pointé du doigt le projet d’Obama pour la Sécurité Sociale, pourtant très inspiré par le sien, en criant aux kolkhozes. Sa phrase, terrible, contre les électeurs d’Obama, figure dans les annales de l’élitisme arrogant et méprisant : «Il y a 47% d’Américains qui voteront Obama, peu importe ce que je fasse ou dise… 47% qui vivent de l’aide sociale, ne paient pas d’impôt, qui se pensent des victimes… Je n’ai pas besoin de m’en préoccuper, si ce n’est pour leur dire de se prendre en charge eux-mêmes». De même, quand Trump a été nommé candidat, Romney n’avait pas de mots assez durs contre la folie de Trump et le danger que son élection représentait. Puis, une fois Trump élu, Romney s’est livré à une invraisemblable entreprise de courtisanerie, dans le but d’être nommé ministre des Affaires étrangères. Trump, sadique, a laissé faire, puis l’a humilié en public.
Romney n’est donc pas ce soldat candide de la rectitude morale qu’il s’est entrepris d’incarner. Mais, son vote pourrait être admirable, si Romney prenait vraiment des risques. Depuis mercredi, jour du scrutin, on le compare, avantageusement, à John McCain : un «maverick», un hors-la-loi, un membre important du Parti Républicain mais qui ose dire sa vérité. Sauf que le contexte est différent. Romney est milliardaire, il n’a pas à affronter d’élection jusqu’en 2024, et sa vie politique est derrière lui. Surtout, il savait très bien que son vote solitaire n’allait avoir aucune conséquence : Trump n’allait pas tomber à cause de lui. Quand McCain prenait des risques, c’était beaucoup plus déterminant : c’est la voix de McCain au Sénat, le poids de cette unique voix, qui a fait pencher la balance et a permis à Obama de faire passer son projet de Sécurité Sociale.
Bien entendu, il ne faut pas être cynique. Romney, aussi, prend des risques. Il est grillé, pour quelques temps, chez les conservateurs – sa propre nièce, responsable locale des Républicains, a appelé à sa démission et à son remplacement. Romney est aussi un homme de l’Utah, un ultra-religieux qui a pu éprouver, en effet, une crise morale. Mais il va lui falloir prendre beaucoup plus de risques, à des moments davantage cruciaux, pour devenir ce qu’il prétend être : le chevalier blanc de l’anti-Trumpisme.


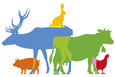






























 Le sénateur républicain Mitt Romney.
Le sénateur républicain Mitt Romney.


 Kirk Douglas dans La Caravane de feu, en 1967. (ARCHIVES DU 7EME ART)
Kirk Douglas dans La Caravane de feu, en 1967. (ARCHIVES DU 7EME ART)


 L’organisation terroriste, désormais dépourvue de territoire, est parvenue à augmenter le nombre de ses attaques en Irak fin 2019.
L’organisation terroriste, désormais dépourvue de territoire, est parvenue à augmenter le nombre de ses attaques en Irak fin 2019. 

 Des soldats américains lors d'une visite du commandant des forces américaines et de l'Otan, le 6 juin 2019, au poste de contrôle du district de Nerkh, en Afghanistan. (THOMAS WATKINS / AFP)
Des soldats américains lors d'une visite du commandant des forces américaines et de l'Otan, le 6 juin 2019, au poste de contrôle du district de Nerkh, en Afghanistan. (THOMAS WATKINS / AFP)



